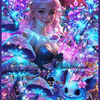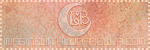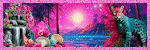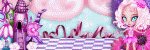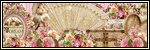-
En 1843, la veille de Noël, Ebenezer Scrooge, un vieil usurier misérable d'une maison de comptage londonienne, ne partage pas la joie de Noël. Il décline l'invitation de son joyeux neveu Fred Holywell à un dîner de Noël, et rejette l'offre de deux messieurs de collecter de l'argent pour la charité. Son fidèle employé Bob Cratchit demande à Scrooge de lui permettre de prendre un jour de congé le jour de Noël pour passer du temps avec sa famille, ce à quoi Scrooge accepte à contrecoeur avant de partir. Dans sa maison, Scrooge reçoit la visite du fantôme de son associé décédé Jacob Marley, qui l'avertit de se repentir de ses mauvaises manières ou il sera condamné dans l'au-delà comme il l'était, portant de lourdes chaînes forgées de sa propre cupidité. Jacob informe Scrooge que trois esprits vont lui rendre visite pour le guider hors de sa misère.
Scrooge reçoit la visite du fantôme des Noël passés, un fantôme en forme de bougie, qui le ramène à ses débuts. Ils visitent le pensionnat de Scrooge. Scrooge voit sa sœur Fanie, morte après avoir donné naissance à Fred. Plus tard, Scrooge entame une carrière réussie dans le monde des affaires et du crédit d'argent en tant qu'employé de Fezziwig, et il s'engage auprès d'une femme nommée Belle. Cependant, le fantôme montre à Scrooge comment Belle l'a quitté quand il est devenu obsédé par la richesse. Scrooge dévasté éteint l'esprit avec son chapeau de bougie à priser, mais Scrooge est propulsé à des milliers de pieds dans les airs tout en s'accrochant sur le preneur, pour le faire disparaître, ce qui fait que Scrooge retombe sur terre et retourne dans sa chambre pour la prochaine visite.
Scrooge rencontre le joyeux fantôme de Noël présent, qui lui montre les joies et les merveilles du jour de Noël. Scrooge et le Fantôme visitent la maison de Bob, apprenant que sa famille est satisfaite de leur petit dîner, Scrooge prenant pitié du fils malade de Bob, Tiny Tim. Le fantôme vieillit brusquement, commentant que Tiny Tim ne survivra probablement pas avant Noël prochain. Le fantôme met Scrooge en garde contre les maux de l'« ignorance » et du « vouloir »; Big Ben commence à sonner le glas de minuit comme « Ignorance » et « Vouloir » se manifestent devant Scrooge comme deux enfants misérables qui deviennent des individus violents et fous, laissant l'esprit se dessécher, mourant longuement lorsque minuit frappe (au point de se dissoudre dans un squelette avant la douzième frappe).
Le fantôme de Noël à venir arrive, apparaissant comme une ombre sombre, et emmène Scrooge dans le futur. Il est témoin d'un groupe d'hommes d'affaires discutant de la mort d'un homme sans nom où ils assisteraient aux funérailles seulement si le déjeuner est fourni ; Scrooge est alors poursuivi à travers Londres par le fantôme et découvre plus tard que ses biens sont volés et vendus par sa bonne Mme Dilber. Peu de temps après, Scrooge voit un cadavre couvert sur un lit, suivi d'une famille soulagée qu'il soit mort, car ils ont plus de temps pour rembourser leur dette. L'esprit transporte Scrooge à la résidence de Bob, découvrant que le petit Tim est mort. Scrooge est ensuite emmené dans un cimetière, où le fantôme montre sa propre tombe, confirmant que Scrooge est l'homme qui est mort. Scrooge promet de changer ses habitudes au moment où le Fantôme l'oblige à tomber dans son cercueil vide, couché dans une tombe profonde qui repose au-dessus des flammes de l'Enfer.
Réveillé dans sa propre chambre le jour de Noël, avec amour et bonheur dans son cœur, un joyeux Scrooge décide de surprendre la famille de Bob avec un dîner de dinde, et s'aventure avec les travailleurs caritatifs et les citoyens de Londres pour répandre le bonheur dans la ville, et plus tard assiste au dîner de Noël annuel de son neveu, où il est chaleureusement accueilli. Le lendemain, il donne une augmentation à Cratchit et devient comme « un second père » pour Tiny Tim, qui échappe à la mort. Homme transformé, Scrooge traite maintenant tout le monde avec gentillesse, générosité et compassion; il incarne maintenant l'esprit de Noël.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Au vent joyeux de la bonne nouvelle
L’étable s’ouvre; et sa merveille est telle
Que les naïfs bergers en sont troublés.Illuminant la crèche sombre encore,
L’Enfant paraît en un orbe d’aurore,
Plus blond que l’or des méteils et des blés.Tout reluit sous l’humble chaume en ruine;
Tout y rutile. Ô nuits de Palestine,
De vos ciels d’aube pâle, est-ce un reflet?Lune magique, est-ce ton sortilège?
Est-ce l’éclat de ta blancheur de neige?
Est-ce ton charme, ô bel enfantelet?Un homme est là, grave comme en un temple;
Hiératique, il admire, il contemple,
Ne sachant plus que bénir à genoux.Dans son long voile et dans sa blanche robe,
Pudique et belle, aux regards se dérobe
Une humble femme au profil triste et doux.Couple candide, ils restent sans parole,
Le front ceint d’une opaline auréole,
Navrés d’amour et de ravissement.Le père exulte, et la mère soupire;
Tendre, elle fait effort pour lui sourire,
Mais son sourire expire tristement.Elle, la Sainte, elle, l’Immaculée,
Oh! comme elle est confuse, émerveillée,
Toute à son rêve et toute à son affront.Elle se voit dans une bergerie,
Et, pour son Christ, non pour elle, Marie
Pleure, le glaive au coeur, l’épine au front.Le nouveau-né, demi-nu, que l’haleine
Du boeuf et de l’âne réchauffe à peine,
Tout frêle et tout mignon, tremble et vagit.La plus modeste entre toutes les mères
Se meurt de honte, et le sang de ses pères
Comme une pourpre à sa tempe rougit.Dans ce réduit de misère, les anges,
Venus du ciel, modulent les louanges
Du gracieux petit roi de Sion.L’oreille entend la harpe qui console,
La tendre lyre et la tendre viole,
Et le théorbe et le psaltérion;Mais ni le luth qui berce et qui caresse,
Ni la viole exquise de tendresse,
Rien n’a charmé le souci maternel.Pensive, au bord de la crèche accoudée,
Elle pressent, crucifiante idée,
Quelque chagrin qui lui semble éternel.Les séraphins suspendent leur cantique :
Et l’âpre son du hautbois bucolique
Se mêle au frais gazouillis des pipeaux.La corne a pris sa voix la plus câline,
Et le roseau langoureux, en sourdine,
Chante à ravir l’âme des bleus oiseaux.On croit ouïr les endormeuses plaintes
De l’air parmi les légers térébinthes,
Du soir parmi les pâles oliviers.En la blancheur de la lumière astrale
Monte et descend la fraîche pastorale
Que dit le choeur rustique des bouviers.Cette musique élyséenne coule
Et, vrai miracle, ondule et se déroule,
S’achève et file en sanglots inouïs.Des femmes vont à l’adorable Juive
Offrir, avec la myrtille et l’olive,
Roses et lis tout frais épanouis.Silencieux, dévalant les collines,
Orientés par les clartés divines,
Déjà, voici les chameliers du Nil.Ils ont offert l’ambre et le cinnamome
Et ces lotus d’oasis dont l’arome
Calme et guérit le mal le plus subtil.Ni les soupirs des pipeaux et des flûtes,
Ni le noël des chevriers hirsutes,
Rien n’a charmé le maternel souci;Ni les lotus, ni les lis de Judée,
Ni l’oliban des rois de la Chaldée,
Rien ne l’allège et rien ne l’adoucit.Dans son berceau, que la mousse encourtine,
L’enfant s’éveille, et sa lèvre enfantine
S’ouvre et sourit d’un sourire de ciel.Sur cette bouche idéalement rose,
La Mère, moins songeuse, moins morose,
Pose un baiser mouillé de pleurs de miel.Ô tendres pleurs, délicieuses larmes,
Est-il quelqu’un qui résiste à vos charmes?
Femme, tes pleurs font pleurer tous les yeux!Dès son réveil, calme, à celle dont l’âme
D’inquiétude et d’angoisse se pâme,
Le Fils envoie un regard radieux.Nul pavillon d’impérator n’égale
Ce gîte où luit la gloire filiale,
Ce lit de paille aux rideaux de soleil.Le pâtre adore et Joseph s’extasie :
Certes, jamais les huchiers de l’Asie
Ni les bouviers n’ont vu tableau pareil.Vision rose, exquise épiphanie,
Divine idylle à jamais non finie,
Charmante encore après dix-huit cents ans!Aux Bethléem mystiques, des deux Mondes
Peuples et rois, caravanes profondes,
À pleines nefs apportent des présents.Bercail d’azur, asile de mystère,
Où le noël amoureux de la terre
Alterne avec le cantique des cieux!Crèche où naquit l’agneau des paraboles,
Agreste autel des célestes symboles,
Je vois s’ouvrir ton chaume harmonieux.Tout ébloui, sur le seuil je m’arrête,
Je me prosterne et je courbe la tête,
Dans la pénombre, en silence, à l’écart.Pour te louer, divin berceau, j’aspire
L’harmonieux lyrisme qu’on respire
Dans les motifs des aèdes de l’art.Ô Mère pure, ô Vierge maternelle,
Vase de nard qui déborde et ruisselle,
Inonde-moi des flots de ton amour!Je veux bercer ta peine et ta hantise,
Adoucir le mal qui te martyrise,
Je veux aimer ton Jésus sans retour.Suivant les pas des bergers et des Mages,
Je viens offrir l’encens de mes hommages.
Que n’ai-je l’or des antiques Crésus!Oh! laisse-moi, Vierge, Mère divine,
Prendre en mes bras, presser sur ma poitrine,
Ton bien-aimé, ton trésor, ton Jésus!Je veux que ma lèvre à sa lèvre touche.
Combien heureux je serais, si ma bouche
Pouvait chanter un chant digne de toi!Mais c’est en vain que mon hymne s’élance.
Suspends ton rythme, ô mon coeur, le silence
Exprime seul mon extatique émoi.Nérée Beauchemin, Les floraisons matutinales
 2 commentaires
2 commentaires
-

Que j’aime le premier frisson d’hiver ! le chaume,
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer !
Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume,
Au fond du vieux château s’éveille le foyer ;C’est le temps de la ville. – Oh ! lorsque l’an dernier,
J’y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme,
Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume
(J’entends encore au vent les postillons crier),Que j’aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine
Sous ses mille falots assise en souveraine !
J’allais revoir l’hiver. – Et toi, ma vie, et toi !Oh ! dans tes longs regards j’allais tremper mon âme
Je saluais tes murs. – Car, qui m’eût dit, madame,
Que votre coeur sitôt avait changé pour moi ?Alfred de Musset
 2 commentaires
2 commentaires
-

bonjour cette creation comme toutes celles qui sont en mouvements m'ont ete offerte par une amie et ancienne d'ekla
Ce conte est emprunté à l'écrivain allemand Hoffmann.
Epoque du récit XVIIIème siècle
XVIIIème siècleLe soir de Noël, Marie trouve parmi les jouets un casse-noisette en forme de bonhomme. Jaloux, son frère Fritz brise les dents du jouet. La nuit venue, la fillette refuse de se coucher sans avoir installé au mieux son casse-noisette dans l'armoire quand, à minuit, des bruits se font entendre. Marie découvre avec terreur son parrain Drosselmayer assis sur l'horloge et voit des milliers de souris commandées par un roi à sept têtes. Tandis que les rongeurs se rangent en ordre de bataille, les jouets descendent de l'armoire et choisissent Casse-noisette pour général. La joute s'engage mais très vite les souris menacent Casse-noisette. Furieuse, Marie jette son soulier sur les assaillants et sauve son ami avant de tomber évanouie.
Le lendemain, Marie raconte l'aventure à ses parents incrédules. Quand arrive Drosselamyer, elle lui reproche de ne pas avoir secouru Casse-noisette. En guise d'explication, il lui raconte comment son neveu, Nathaniel Drosselmayer, fut transformé en casse-noisette par Dame Souriçonne, la mère du Roi des souris. Pour retrouver forme humaine, il doit diriger un combat au cours duquel il lui faut tuer le Roi des souris à sept têtes, puis il doit se faire aimer d'une jolie dame.
Plusieurs nuits plus tard, Casse-noisette supplie la fillette de lui donner une épée. Le lendemain, le Roi des souris est tué en combat régulier au grand bonheur de Marie qui accompagne Casse-noisette dans le royaume des poupées.
A son réveil, Marie montre à ses parents les sept petites couronnes du Roi des souris. Devant leur scepticisme, la fillette éclate en sanglots, affirme qu'elle aime véritablement Casse-noisette et tombe évanouie. Quand elle rouvre les yeux, elle voit son parrain et Nathaniel qui viennent d'entrer. Les enfants sont laissés seuls et le garçon demande à Marie de l'épouser. La fillette accepte et devient souveraine du royaume des poupées.Analyse
 Alexandre Dumas étant un conteur né, l'exercice du conte pour enfants ne peut que lui être agréable et il s'y est à plusieurs reprises essayé (voir entre autres Le roi des taupes et sa fille ou encore La bouillie de la comtesse Berthe). Il n'hésite pas à chercher l'inspiration tant dans la culture populaire des régions et des pays qu'il visite que dans la littérature du genre (chez Andersen ou chez Hoffmann comme c'est le cas ici).
Alexandre Dumas étant un conteur né, l'exercice du conte pour enfants ne peut que lui être agréable et il s'y est à plusieurs reprises essayé (voir entre autres Le roi des taupes et sa fille ou encore La bouillie de la comtesse Berthe). Il n'hésite pas à chercher l'inspiration tant dans la culture populaire des régions et des pays qu'il visite que dans la littérature du genre (chez Andersen ou chez Hoffmann comme c'est le cas ici).
L'entrée en matière de ce récit est des plus savoureuses. Dumas raconte comment il a été contraint, au cours d'une soirée d'enfants à laquelle assistait sa fille, de raconter un conte aux bambins qui l'avaient surpris dans son sommeil et l'avaient attaché sur son fauteuil. L'histoire choisie est celle du Casse-noisette de Nuremberg empruntée à Hoffmann, un charmant conte de Noël.
Tous les ingrédients nécessaires à un succès auprès du jeune public sont réunis: des descriptions de maisons de poupées pour les petites filles et d'alignements de soldats de plomb pour les petits garçons; des rois et des reines tout aussi despotiques que bourgeois (la reine cuisine du boudin et de la purée de foie pour le roi); un héros chevaleresque et intrépide sur lequel s'acharne le sort; des parents tendres et incrédules; des souris qui parlent et se vengent; un énigmatique parrain qui prend parfois des allures de sorcier; une pure et douce jeune fille amoureuse d'un vilain casse-noisette; et bien entendu la fin heureuse et le mariage avec le héros devenu roi...d'Alexandre Dumas
 5 commentaires
5 commentaires
-
bonjour je ne peux vous donner aucuns poser de cette creation car c est des cadeaux d'une amie ainsi que ceux qui ont servi a faire ce blog merci de votre comprehension
Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix : « Un souvenir de Noël ?... Un souvenir de Noël ?... »Et tout à coup, il s’écria :— Mais si, j’en ai un, et un bien étrange encore ; c’est une histoire fantastique. J’ai vu un miracle ! Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël.*Cela vous étonne de m’entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant j’ai vu un miracle ! Je l’ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qui s’appelle vu.En ai-je été fort surpris ? non pas ; car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi, et je sais qu’elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples ; mais je vous indignerais et je m’exposerais aussi à amoindrir l’effet de mon histoire.Je vous avouerai d’abord que si je n’ai pas été fort convaincu et converti par ce que j’ai vu, j’ai été du moins fort ému, et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j’avais une crédulité d’Auvergnat.J’étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie.L’hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelées. On voyait de loin les gros nuages venir du nord ; et la blanche descente des flocons commença.En une nuit, toute la plaine fut ensevelie.Les fermes, isolées dans leurs cours carrées, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s’endormir sous l’accumulation de cette mousse épaisse et légère.Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s’abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs.On n’entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours.Cela dura huit jours pleins, puis l’avalanche s’arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de cinq pieds.Et, pendant trois semaines ensuite, un ciel, clair comme un cristal bleu le jour, et, la nuit, tout semé d’étoiles qu’on aurait crues de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s’étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges.La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni hommes ni bêtes ne sortaient plus : seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée, par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l’air glacial.De temps en temps on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l’écorce ; et, parfois, une grosse branche se détachait et tombait, l’invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres.Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de cent lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j’essayais d’aller voir mes clients les plus proches, m’exposant sans cesse à rester enseveli dans quelque creux.Je m’aperçus bientôt qu’une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n’était point naturel. On prétendit qu’on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient.Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule, et qui fuyaient en masse vers le sud. Mais allez donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s’attendait à un événement extraordinaire.La forge du père Vatinel était située au bout du hameau d’Épivent, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d’aller jusqu’au village. Il resta quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur épandue sur la campagne.Et il se remit en route avant la nuit.Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf sur la neige ; oui, un œuf déposé là, tout blanc comme le reste du monde. Il se pencha, c’était un œuf en effet. D’où venait-il ? Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit ? Le forgeron s’étonna, ne comprit pas ; mais il ramassa l’œuf et le porta à sa femme.— Tiens, la maîtresse, v’là un œuf que j’ai trouvé sur la route !La femme hocha la tête :— Un œuf sur la route ? Par ce temps-ci, t’es soûl, bien sûr ?— Mais non, la maîtresse, même qu’il était au pied d’une haie, et encore chaud, pas gelé. Le v’là, j’me l’ai mis sur l’estomac pour qui n’refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner.L’œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu’on disait par la contrée.La femme écoutait, toute pâle.— Pour sûr que j’ai entendu des sifflets l’autre nuit, même qu’ils semblaient v’nir de la cheminée.On se mit à table, on mangea la soupe d’abord, puis, pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l’œuf et l’examina d’un œil méfiant.— Si y avait quéque chose dans c’t’œuf ?— Qué que tu veux qu’y ait ?— J’sais ti, mé ?— Allons, mange-le, et fais pas la bête.Elle ouvrit l’œuf. Il était comme tous les œufs, et bien frais.Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait :— Eh bien ! qué goût qu’il a, c’t’œuf ?Elle ne répondit pas et elle acheva de l’avaler ; puis, soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés ; leva les bras, les tordit et, convulsée de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles.Toute la nuit elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier.Et elle hurlait sans repos, d’une voix infatigable :— J’l’ai dans l’corps ! J’l’ai dans l’corps !Je fus appelé le lendemain. J’ordonnai tous les calmants connus sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle.Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l’obstacle des hautes neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme : « La femme au forgeron qu’est possédée ! » Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison ; on écoutait de loin ses cris affreux poussés d’une voix si forte qu’on ne les aurait pas crus d’une créature humaine.Le curé du village fut prévenu. C’était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis comme pour administrer un mourant et il prononça, en étendant les mains, les formules d’exorcisme, pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue.Mais l’esprit ne fut point chassé.Et la Noël arriva sans que le temps eût changé.La veille au matin, le prêtre vint me trouver :— J’ai envie, dit-il, de faire assister à l’office de cette nuit cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, à l’heure même où il naquit d’une femme.Je répondis au curé :— Je vous approuve absolument, monsieur l’abbé. Si elle a l’esprit frappé par la cérémonie (et rien n’est plus propice à l’émouvoir), elle peut être sauvée sans autre remède.Le vieux prêtre murmura :— Vous n’êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi, n’est-ce pas ? Vous vous chargez de l’amener ?Et je lui promis mon aide.Le soir vint, puis la nuit ; et la cloche de l’église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l’espace morne, sur l’étendue blanche et glacée des neiges.Des êtres noirs s’en venaient lentement, par groupes, dociles au cri d’airain du clocher. La pleine lune éclairait d’une lueur vive et blafarde tout l’horizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs.J’avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge.La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On la vêtit proprement malgré sa résistance éperdue, et on l’emporta.L’église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide ; les chantres poussaient leurs notes monotones ; le serpent ronflait ; la petite sonnette de l’enfant de chœur tintait, réglant les mouvements des fidèles.J’enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère, et j’attendis le moment que je croyais favorable.Je choisis l’instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin.Sur mon ordre, la porte fut ouverte et mes quatre aides apportèrent la folle.Dès qu’elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le chœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d’une telle vigueur, qu’elle faillit nous échapper, et elle poussa des clameurs si aiguës qu’un frisson d’épouvante passa dans l’église ; toutes les têtes se relevèrent ; des gens s’enfuirent.Elle n’avait plus la forme d’une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous.On la traîna jusqu’aux marches du chœur et puis on la tint fortement accroupie à terre.Le prêtre s’était levé ; il attendait. Dès qu’il la vit arrêtée, il prit en ses mains l’ostensoir ceint de rayons d’or, avec l’hostie blanche au milieu, et, s’avançant de quelques pas, il l’éleva de ses deux bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant aux regards effarés de la démoniaque.Elle hurlait toujours, l’œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant.Et le prêtre demeurait tellement immobile qu’on l’aurait pris pour une statue.Et cela dura longtemps, longtemps.La femme semblait saisie de peur, fascinée ; elle contemplait fixement l’ostensoir, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d’une voix moins déchirante.Et cela dura encore longtemps.On eût dit qu’elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu’ils étaient rivés sur l’hostie ; elle ne faisait plus que gémir ; et son corps raidi s’amollissait, s’affaissait.Toute la foule était prosternée le front par terre.La possédée maintenant baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s’était tue. Et puis soudain, je m’aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des somnambules, hypnotisée, pardon ! vaincue par la contemplation persistante de l’ostensoir aux rayons d’or, terrassée par le Christ victorieux.On l’emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l’autel.L’assistance bouleversée, entonna un Te Deum d’actions de grâces.Et la femme du forgeron dormit quarante heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance.Voilà, mesdames, le miracle que j’ai vu.*Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d’une voix contrariée : « Je n’ai pu refuser de l’attester par écrit. »25 décembre 1882 7 commentaires
7 commentaires